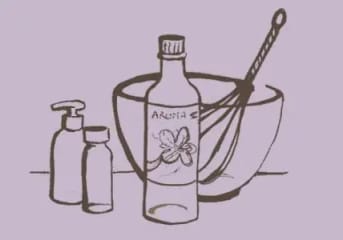A travers les siècles, le Thym a su se tailler une place de choix dans l'usage des plantes médicinales. Les Egyptiens l'utilisaient pour embaumer les momies aux côtés d'autres plantes comme la Myrrhe, l'Oliban, la Sarriette. Durant l'Antiquité, les Grecs et les Romains se plongeaient dans des bains de plantes revigorants où infusaient des touffes de Thym. Le Thym était également utilisé à l'époque sous forme de fumigations de plantes sèches pour purifier l'air, en cataplasmes, en onction et massage avec une huile de Thym (macération huileuse) pour ses propriétés médicinales et ses bienfaits.
Au Moyen-äge, Hildegarde de Bigen, célèbre nonne, docteure, musicienne et botaniste indiquait "le Thym, additionné d'autres bonnes herbes et condiments, enlève les putréfactions des maladies grâce à sa chaleur et sa force".
A la fin du 18e siècle, Nicolas, Lemery, scientifique français contemporain de Louis XIV, le cite comme un tonique cérébral, digestif, anti-toxique et tonique utérin pour faciliter l'accouchement.
Au début du 20e siècle, l'action bactéricide de l'huile essentielle de Thym sur le bacille du charbon de la typhoïde est prouvé, puis sur le méningocoque, le bacille d'Eberth, le bacille diphtérique et le staphylocoque.
Aujourd'hui, de nombreuses études scientifiques ont mis en lumière notamment l'activité antibactérienne de l'huile essentielle de Thym via des études cliniques in vitro sur des souches bactériennes de références ou isolées cliniquement. [1][2]